

Les effets spéciaux numériques
La Science au service
du 7ème Art

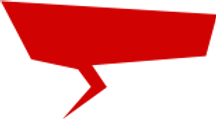
Souriez,
vous êtes filmé !
B - La réalité manipulée
Il y a des cinéastes qui croient à l'image, d'autres qui croient à la réalité... En d'autres termes, certains cinéastes croient au tournage et à la réalité des effets tandis que d'autres croient à la postproduction et aux images des effets.
On peut donc distinguer deux types d'effets spéciaux. Ceux qui manipulent la réalité et ceux qui manipulent l'image.
Le maquillage : Les limites du corps
Le maquillage est l'un des premiers effets et le plus utilisé pour corriger l’aspect de la peau en fonction de la pellicule choisie et de l’éclairage mais aussi pour masquer les défauts de la peau.
L'un des plus grands exemples de cette catégorie serait bien La Planète des Singes réalisé par Franklin J. Schaffner en 1967. John Chambers créa ainsi une dizaine de personnages pour ce film et développa des techniques pour produire des prothèses à grande échelle.
L'acteur se voit donc manipulé par l'apparition du maquillage. On chercha également à manipuler les décors et les accessoires, notamment grâce à la peinture sur verre.
Les élèves de l'école de maquillage de Genève, Studio Tannaz, se sont essayés à la fabrication de prothèses sur le thème de La Planète des Singes.
La peinture sur verre : l'art pictural au service des effets spéciaux
Il s'agit de réaliser des peintures sur un support en verre que l'on superpose au décor réel devant la caméra afin de l'intégrer dans le décor initial.
La technique différe quelque peu de celle des peintres habituels : la peinture sur verre ne vise pas le réalisme, mais plutôt un photoréalisme (ou un « ciné-réalisme »), basé sur le flou, et sur une impression d'ensemble.

Albert Whitlock, l'un des plus grands peintre sur verre, en train de réaliser une oeuvre pour le film catastrophe Earthquake de Mark Robson (1974).

Un artiste réalise une peinture sur verre pour La Guerre des Etoiles de George Lucas (1977).
Les années soixante, entre autres, seront remplies de tremblement de terre, de naufrages, de catastrophes aériennes... réalisés à l'aide de la peinture sur verre et de maquettes.
Les maquettes : un monde à notre image

Une maquette est la représentation en trois dimensions, le plus souvent à échelle réduite, mais fidèle dans les proportions d'une construction, d'un appareil, d'un décor, d'un objet quelconque.
Ainsi, les maquettes sont utilisées depuis le début du siècle pour des raisons budgétaires, d'accessibilité et de maniabilité.
L'un des exemples les plus célèbres du siècle dernier serait bien celui du film de George Lucas, La Guerre des Etoiles de 1977 avec ses vaisceaux en miniatures. Celles-ci vont être dotées d'explosifs par le célèbre pyrotechnicien Joe Viskocil, en vue d'exploser lors d'une scène du film.
L'évolution des techniques a permis de mieux comprendre la télécommunication des systèmes mécaniques. Le cinéma s'en est ainsi servi pour développer une nouvelle technique : l'animatronique.
Joe Viskocil en train d'installer un dispositf explosif sur l'un des vaisceaux spatiaux de La Guerre des Etoiles
L'Animatronique : l'homme machine
Le terme "animatronique" est la contraction de "animation électronique". On ne parle donc pas d'animaux mais de toutes sortes de créatures, réelles ou non, que l'on va représenter par un système animé et robotisé que l'on peut parfois téléguider pour agir lors d'une scène de tournage. Cette technique s'est développée à partir des années 1980 avec le personnage de E.T. Elle évolua jusqu'à aujourd'hui pour permettre d'autres réalisations, du plus petit avec la souris de Stuart Little (Rob Minkoff, 1999), au plus grand avec les dinosaures de Jurassik Parc (Steven Spielberg, 1993).

Voici Le robot qui fut utilisé pour le personnage de E.T. dans le film de Steven Spielberg, E.T. L'extra-terrestre (1982)

L'énorme robot du Tyrannausorus Rex dans le film de Jurassik Parc
Ainsi, la maquette est-elle poussée dans ces derniers retranchements avec sa mécanisation. Or cela n'a bien sûr pas suffit aux cinéastes qui désiraient animer des paysages fictifs tout entier. Ils ont donc eu l'idée d'utiliser une toile transparente...
La transparence

La transparence se compose d'un écran semi-transparent (d'où le nom français), sur lequel est projetée une image par-derrière (d'où le nom anglais, back ou rear projection). Devant l'écran, un acteur joue son rôle, tandis que défile derrière lui un paysage, un monstre ou bien lui-même, filmé précédemment.
Schéma représentant le principe de la transparence
Manipuler la réalité est l'objet d'une palette d'outils plutôt riche, mais certains effets spéciaux nécessitent de manipuler autre chose que la réalité : l'image.